Recevez nos actualités
Une veille citoyenne, au service de l’intérêt général. Recevez les enquêtes, alertes et pétitions de l'ODJ directement dans votre boîte mail.
Pas de spam. Fréquence mensuelle.
Nous soutenir autrement :
Une veille citoyenne, au service de l’intérêt général. Recevez les enquêtes, alertes et pétitions de l'ODJ directement dans votre boîte mail.
Pas de spam. Fréquence mensuelle.
Nous soutenir autrement :
Une veille citoyenne, au service de l’intérêt général.
Nous soutenir autrement :
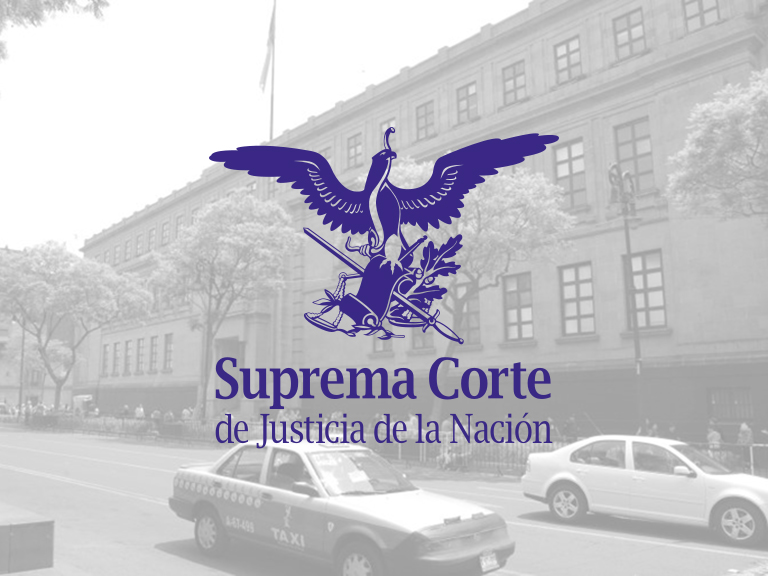
Le Mexique a franchi une étape historique en faisant élire par le peuple ses juges fédéraux, de la Cour suprême aux tribunaux locaux, le 1er juin 2025. Cette réforme, portée par la gauche au pouvoir, vise à lutter contre la corruption et le népotisme. Mais ce modèle peut-il inspirer d’autres pays comme la France, confrontés à des crises de légitimité judiciaire ?
Le 1er juin 2025, le Mexique a organisé une élection inédite pour désigner 881 juges fédéraux, dont les neuf membres de la Cour suprême, ainsi que 1 700 juges dans 19 États. Cette réforme constitutionnelle, promulguée en septembre 2024 par l’ex-président Andrés Manuel López Obrador et soutenue par son successeur Claudia Sheinbaum, ambitionne de purger un système judiciaire accusé de corruption et d’inefficacité. Selon la présidente, « la moitié du pouvoir judiciaire est arrivée là par népotisme », tandis que l’impunité règne face aux 30 000 homicides annuels.
Scruté par de nombreux observateurs, ce scrutin a toutefois révélé quelques failles. D’abord celle de la participation. Avec une mobilisation allant, selon les États de 12,57% à 13,32 % du corps électoral, soit environ 13 millions d’électeurs sur un total de 100 millions, la participation populaire a été très faible. Il n’est pas impossible que la complexité du système de vote ait contribué à cette faible mobilisation : il ne fallait à l’électeur pas moins de six bulletins pour choisir parmi des centaines de candidats souvent inconnus ; qui plus est, le faible nombre de bureaux de vote aura également pu décourager les citoyens. Des polémiques ont également accompagné la réforme. Au cours de la campagne, plusieurs manifestations se sont tenues, dénonçant le risque de mise en place d’une « dictature » et d’une politisation accrue de la justice. L’opposition, menée par le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI1) a qualifié le processus de « farce », tandis que des candidats controversés, comme Silvia Delgado, ancienne avocate du narcotrafiquant « El Chapo », ont suscité l’inquiétude.
Malgré ces critiques, le parti Morena ( Mouvement de régénération nationale) défend une réforme se donnant notamment comme objectif d’ouvrir la justice aux minorités (spécialement les 20 % d’indigènes). Cependant, l’absence de mesures favorisant leur candidature a limité cet objectif.
L’élection des juges, bien que rare, existe dans d’autres pays, avec des résultats contrastés qui ne sont pas aisément transposables. Aux États-Unis, 39 États fédérés élisent leurs juges locaux ou étatiques, au travers d’élections dites élections partisanes ou non partisanes, selon que les candidats soient ou pas présentés soutenus par les partis politiques (Texas, Ohio…) ; d’autres États connaissent également des élections dites de maintien en place, à l’issue du mandat de leurs juges.
Ce système, ancré dans la tradition de Common law, favorise la responsabilité des juges face aux citoyens, mais suscite des critiques : les campagnes électorales, financées parfois par des avocats plaidant devant ces juges, menacent l’impartialité ; pour autant, la Cour suprême a refusé tout contrôle de ces flux financiers, considérant que cela irait à l’encontre de la liberté d’expression2. En Suisse, certains cantons, comme celui de Vaud, pratiquent l’élection indirecte par les parlements cantonaux, dans un cadre de droit civil où la technicité judiciaire prime3 ; d’autres cantons comme Appenzell ou Glaris conservent la désignation par élection populaire directe. La Bolivie, depuis 2009, élit les juges des hautes juridictions, un modèle plurinational visant à refléter la diversité ethnique, mais les candidatures restent contrôlées par le Parlement.
Ces expériences montrent que l’élection des juges peut renforcer la légitimité populaire dans des contextes où la méfiance envers les élites est forte. Toutefois, elle peut également exposer les juges à des pressions politiques et financières, surtout dans des systèmes où la corruption est endémique.
En France, l’élection des juges est une idée marginale, mais pas inconnue. Pendant la Révolution (1790-1802), les juges de paix et de district étaient élus, reflet de la souveraineté populaire contre l’Ancien Régime. Ce système, abandonné sous le Consulat avec l’avènement des « masses de granit », a laissé place à une magistrature professionnelle recrutée par concours à l’École nationale de la magistrature (ENM) ou nommée par le Chef de l’État, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
Aujourd’hui, ne restent élus que les juges consulaires des tribunaux de commerce (par leurs pairs commerçants) et les juges disciplinaires des ordres professionnels (médecins, avocats…).
La crise de confiance envers la justice française avec 73 % des Français qui estiment qu’elle fonctionne mal, selon un sondage Ifop de 20224, ravive le débat. Marcel Gauchet, dans Le Nœud démocratique ? (2025), défend l’élection des juges pour leur conférer une légitimité populaire, arguant que « la légitimité n’est pas délivrée par un diplôme ». Il critique un « progressisme autoritaire » où les juges, non élus, se substituent à la volonté populaire. Malo Tourquetil, Juriste chez Cocktail Vision et ancien assistant parlementaire LR, voit dans de telles élections un moyen d’« apaiser la société » en renforçant la confiance5. Cependant, aucun parti majeur n’inscrit l’élection des juges dans son programme. Les risques de politisation, de campagnes coûteuses et d’atteinte à l’indépendance judiciaire freinent cette idée. Le risque d’une participation faible plane aussi sur ce type de scrutin et entacherait la légitimité recherchée. A contrario de ce point de vue, le député LR Vincent Jeanbrun, vient de proposer d’ouvrir le débat sur l’élection des juges6, comme l’avaient demandé récemment Bertrand Saint-Germain7 et l’ancien juge Georges Fenech.
L’élection des juges au Mexique, nonobstant son ambition de démocratiser la justice, soulève au moins autant de questions qu’elle n’apporte de solutions. Si elle répond à une crise de légitimité, elle y court le risque de politiser un pouvoir judiciaire déjà fragilisé. En France, où la défiance envers la justice croît, l’idée d’élire les juges, portée par des penseurs comme Marcel Gauchet, reste encore assez théorique et minoritaire, confrontée à une tradition de nomination, ancrée dans la culture de droit civil. A court ou moyen terme, un modèle hybride pourrait être envisagé avec certains juges élus comme c’est déjà le cas pour les tribunaux de commerce ou même la mise en place d’un « examen populaire » lors d’élection comme au Japon où les citoyens peuvent voter pour approuver ou rejeter les juges nommés à la Cour suprême.