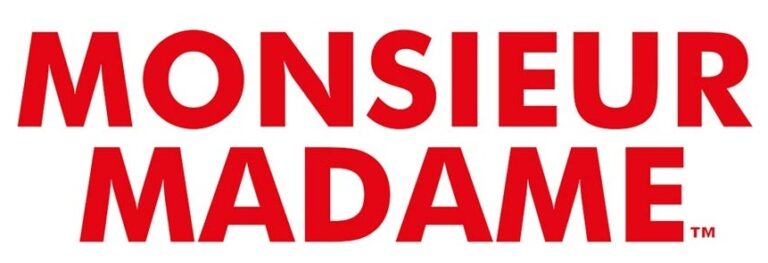Le 31 juillet 2025, le Conseil d’État a condamné l’État à verser 3 000 euros à l’association pro-LGBT+ Mousse au motif que la plateforme SNCF Connect imposait à ses clients de renseigner leur civilité (« Monsieur » ou « Madame ») lors de l’achat de billets1. Une décision fondée sur le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne. Si le raisonnement juridique peut sembler conforme au droit, il n’en illustre pas moins une dérive préoccupante : celle d’un juridisme militant au service d’agendas idéologiques qui instrumentalise le droit pour transformer insidieusement la société en contournant tout débat démocratique.
Une affaire banale devenue symbole
Tout part d’une pratique administrative relativement anodine : jusqu’en mai 2025, la plateforme Internet SNCF Connect imposait à ses usagers de renseigner leur civilité lors de l’achat d’un billet. Une habitude répandue, historiquement liée à la personnalisation des échanges, à l’identification des voyageurs ou à des dispositifs spécifiques comme les compartiments réservés aux femmes seules. Cette exigence a été attaquée par l’association Mousse, militant pour les droits des personnes LGBT+, sur le fondement du RGPD2, notamment son principe de « minimisation des données » (article 5.1.c) qui impose aux responsables de traitement de ne collecter que les données « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées » mais surtout de son article 21 (§1) qui dispose que « la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant ». La CNIL avait initialement rejeté la requête de l’association en 2021. Mais celle-ci s’est pourvue devant le Conseil d’État, lequel a saisi la CJUE d’une question préjudicielle. Dans un arrêt du 9 janvier 2025 (affaire C‑394/233) la Cour européenne a jugé que la collecte systématique de la civilité, si elle ne répond qu’à un objectif de personnalisation commerciale, n’est pas nécessaire à l’exécution d’un contrat de transport. Suivant cette interprétation, le Conseil d’État a rendu sa décision le 31 juillet 20254.
La logique juridique contre le bon sens
Le raisonnement juridique, en apparence rigoureux, révèle en réalité une conception maximaliste du RGPD : celle d’une application détachée des réalités pratiques et des attentes ordinaires des usagers. Faut-il réellement considérer que le fait de cocher « Monsieur » ou « Madame » lors d’un achat constitue une atteinte grave à la vie privée ? Le Conseil d’État, dans son arrêt, reconnaît que certaines situations justifient la collecte de la civilité (comme la possibilité donnée aux femmes de réserver leur voyage de nuit dans des compartiments réservées à elles seules), mais interdit à la SNCF d’en faire une règle générale. La justification juridique du Conseil réside dans le prétexte que la nécessité de collecter la mention du sexe ne serait pas strictement nécessaire dans tous les cas.
Ce glissement sémantique du nécessaire vers l’accessoire n’est pas anodin. Il traduit une tendance préoccupante du droit européen à restreindre l’usage des données à une interprétation très étroite de leur finalité, parfois jusqu’à l’absurde. Cette posture hyperformaliste revient à ignorer les usages sociaux élémentaires et à imposer à l’ensemble de la société une prudence juridique disproportionnée au regard des enjeux réels.
La justice administrative au service d’un militantisme de prétoire
Au-delà de l’aspect juridique, cette décision illustre surtout une instrumentalisation du droit à des fins militantes. L’association Mousse, bénéficiaire d’importants financements publics (notamment de la Ville de Paris et de la Région Île-de-France), se livre depuis plusieurs années à une stratégie de « contentieux stratégique » : en multipliant les recours très ciblés, elle vise à imposer ses revendications idéologiques par la voie judiciaire, contournant ainsi tout débat démocratique. Loin d’être une association de défense générale des libertés, Mousse revendique un agenda politique assumé, s’inscrivant dans ce que certains pourraient appeler une logique woke : effacement des catégories traditionnelles (comme le sexe ou la civilité), primauté des identités ressenties sur les données objectives et contestation systématique des normes sociales jugées « hétéronormées » ou « genrées ». Le Conseil d’État, en faisant droit à cette demande, entérine cette stratégie. Il valide une lecture du droit fondée non plus sur une logique d’équilibre entre les intérêts en présence, mais sur la satisfaction d’exigences minoritaires au nom de la lutte contre les discriminations. Cette approche sape en réalité la neutralité du droit en l’alignant sur des revendications idéologiques spécifiques.
Une CJUE au-delà de son office ?
Plus inquiétant encore est le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne dans cette affaire. Par son arrêt du 9 janvier 2025, elle donne une portée très extensive au RGPD (notamment sur l’interprétation de son art. 21§1) au point d’en faire un outil de transformation sociale. En jugeant qu’un simple formulaire de civilité excède le strict nécessaire à un contrat de transport, la CJUE impose à l’ensemble de l’Europe une conception du droit à la vie privée qui frôle l’ingérence dans les pratiques nationales. Cette judiciarisation excessive, sous couvert de protection des données, devient un levier de normalisation sociale au profit d’une minorité idéologiquement engagée. Ce n’est plus le droit comme garant des libertés mais le droit comme vecteur d’un projet culturel hégémonique.
Une justice qui désincarne le réel
L’affaire SNCF Connect est un symptôme supplémentaire de la maladie affectant le droit contemporain. Elle révèle la manière dont un juridisme apparemment simplement technique peut être utilisé pour imposer, à bas bruit, des choix idéologiques majeurs. En disqualifiant les pratiques sociales traditionnelles comme suspectes, voire discriminatoires, les juridictions administratives alimentent ici un processus de désincarnation du droit : celui-ci ne s’appuie plus sur les réalités humaines et culturelles mais sur des abstractions idéologiques sous couvert de conformité (excessive) aux normes juridiques en vigueur.
Loin d’être simplement anecdotique, cette décision illustre les dérives de notre système juridictionnel. En se soumettant, nolens volens, à des injonctions idéologiques venues de Bruxelles ou de cercles militants et politisés, le Conseil d’État abdique sa fonction de gardien de l’intérêt général. Ce type de jurisprudence, loin de restaurer la confiance dans la justice, la mine un peu plus chaque jour. Le droit n’a pas vocation à servir de levier à des luttes idéologiques. C’est à la représentation nationale de fixer les normes qui structurent la vie collective. À la justice, il revient d’en garantir l’application et non d’en dévoyer l’esprit au profit de causes particulières.
- https://www.conseil-etat.fr/actualites/sncf-connect-doit-rendre-la-collecte-des-donnees-de-civilite-facultative-et-non-obligatoire-sur-son-site-internet ↩︎
- https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/ ↩︎
- https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=294110&doclang=fr ↩︎
- https://www.lejdd.fr/Societe/la-sncf-ne-peut-plus-demander-a-ses-clients-sils-sont-monsieur-ou-madame-tranche-le-conseil-detat-160680 ↩︎